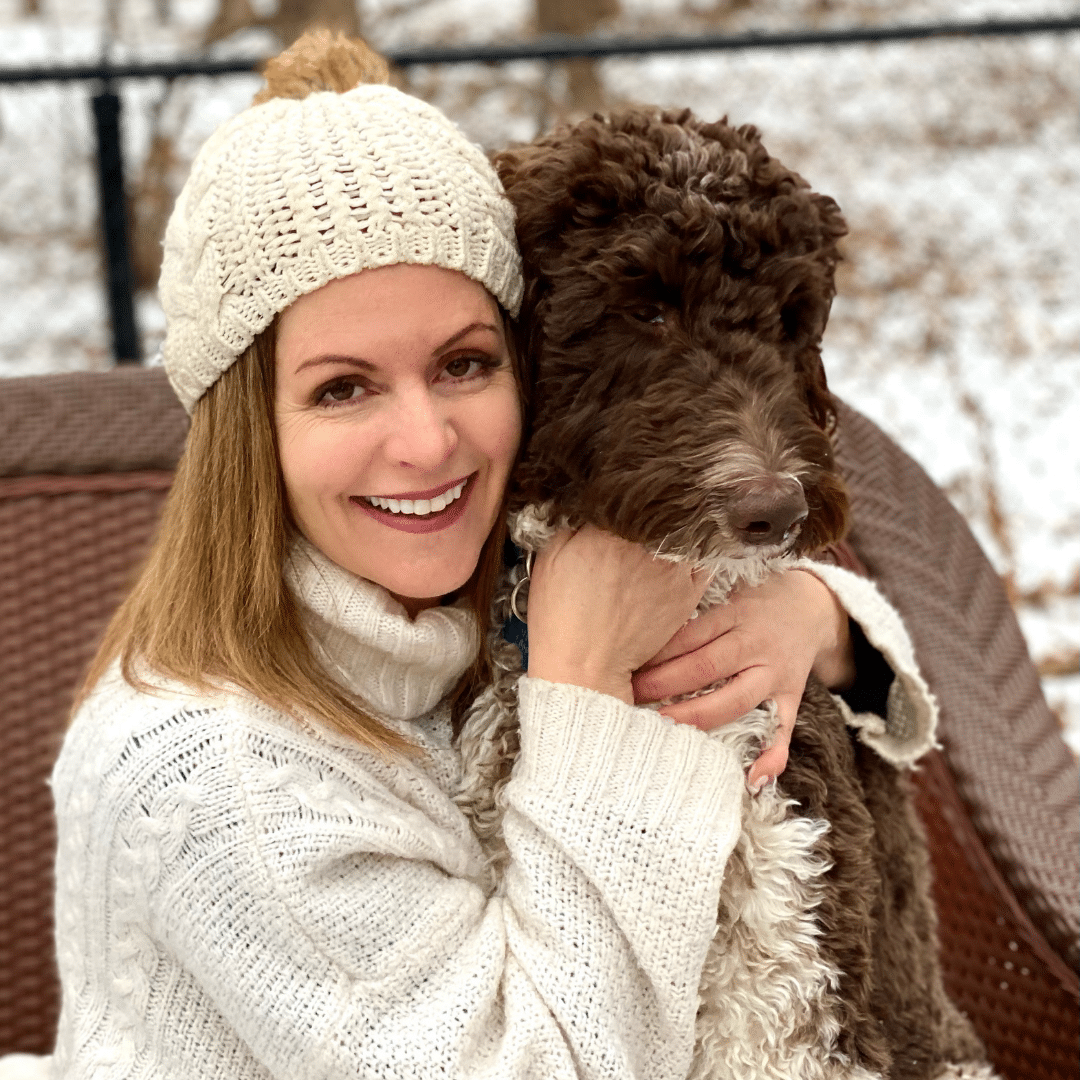Ils ont un parcours brillant, exercent leur métier avec passion et rendent hommage au lien humain-animal, chacune à leur façon. Chaque mois, découvrez le portrait d’une femme particulièrement inspirante. Rencontre avec Dre Catherine Bouchard, vétérinaire épidémiologiste à l’Agence de santé publique du Canada.
Catherine, comment as-tu choisi de te diriger vers la médecine vétérinaire ?
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé les animaux. J’ai grandi en campagne, dans le petit village de Lac-Etchemin, dans la région de Chaudière-Appalaches. Mes parents possédaient une pisciculture. Nous avons eu plusieurs chiens et j’adorais observer les animaux dans la forêt. Le décès récent de Jane Goodall m’a fait prendre conscience à quel point elle avait été une source d’inspiration pour moi. Cette primatologue et anthropologue britannique, qui a dédié sa vie à l’étude des chimpanzés, avait éveillé deux grands rêves en moi : devenir vétérinaire et aller en Afrique.
Pourquoi était-elle si inspirante lorsque tu étais enfant ?
Je trouvais ses recherches fascinantes. D’ailleurs, lorsque je suis entrée en médecine vétérinaire, je voulais travailler avec les animaux sauvages. À force de multiplier les stages liés à la faune, je me suis retrouvé avec deux options : pratiquer la médecine exotique/Zoo Ecomuseum ou entreprendre une maîtrise sur les tiques.
Et tu as choisi les tiques ?
Eh oui ! (rires) Deux ans auparavant, j’avais fait un stage en Afrique, au Kenya et en Tanzanie ! Avec deux collègues étudiantes, nous avions remarqué que les vaches les plus parasitées étaient souvent aveugles. Les vétérinaires locaux nous ont expliqué que la cause de leur cécité était un parasite sanguin transmis par les tiques. Les conséquences économiques étaient majeures pour les habitants, dont les troupeaux de subsistance étaient gravement touchés. C’est là que j’ai réalisé l’impact que pouvaient avoir les travaux de vétérinaire épidémiologiste sur la santé des animaux et des humains.
Maintenant que tu travailles comme vétérinaire épidémiologiste à l’Agence de santé publique du Canada, t’arrive-t-il encore d’aller sur le terrain pour ramasser des tiques ?
Bien sûr ! Je suis professeure associée à la Faculté de médecine vétérinaire, et il m’arrive d’accompagner sur le terrain des étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Toutefois, je consacre maintenant une plus grande part de mon temps à la conception et à la gestion de projets de recherche, en collaboration avec des professeurs d’universités canadiennes, d’autres chercheurs et diverses organisations gouvernementales.
Lorsque tu parles de ton travail d’épidémiologiste qui consiste à étudier les tiques, quelle est la réaction des gens ?
Ça dépend ! (rires) Certains sont fascinés et me posent 1001 questions, alors que d’autres ont du mal à cacher leur dégoût. Bref, les tiques ne laissent personne indifférent ! Et tant mieux, car il s’agit d’un véritable enjeu de santé publique. Les tiques peuvent transmettre des bactéries, virus ou autres agents pathogènes à l’humain lors d’une piqûre. La plus connue de ces maladies étant la maladie de Lyme, causée par la bactérie Borrelia.
Y a-t-il un lien avec les changements climatiques ?
Oui, vraiment. Lorsque j’ai commencé à étudier les tiques dans le cadre de mon doctorat en 2008, je travaillais sur le terrain de juin à octobre. Aujourd’hui, la saison d’activité des tiques s’allonge selon les régions. Comme la fenêtre d’exposition est plus longue, leur cycle de vie s’étire aussi, ce qui augmente le risque d’infection auprès de la population.
Y a-t-il des fausses croyances à déconstruire au sujet des tiques ?
Oui ! Plusieurs croient que les tiques tombent des arbres, qu’elles sautent ou encore qu’elles volent, mais c’est faux. Elles se maintiennent plutôt sur la végétation basse, où elles profitent de l’humidité du sol. Puis, elles s’agrippent aux animaux ou aux humains qui passent à proximité, pour ensuite les piquer.
En terminant, que doit-on surveiller au niveau épidémiologique au Québec ?
Un de mes projets actuels porte sur la surveillance de l’anaplasmose au Québec. C’est une infection bactérienne transmise principalement par la tique à pattes noires. Pour l’instant, des cas humains infectés ont été signalés surtout en Estrie — la région où l’on retrouve aussi le plus de cas de maladie de Lyme. Nous avons donc développé des projets de maîtrise, afin d’identifier quels réservoirs naturels expliquent l’émergence régionale de cette infection bactérienne.
Psst…
Catherine Bouchard est vétérinaire épidémiologiste (chercheure scientifique) à l’Agence de santé publique du Canada, cheffe de l’unité tiques et maladies transmises par les tiques au sein de la division Hub de modélisation, et professeure associée à l’Université de Montréal.